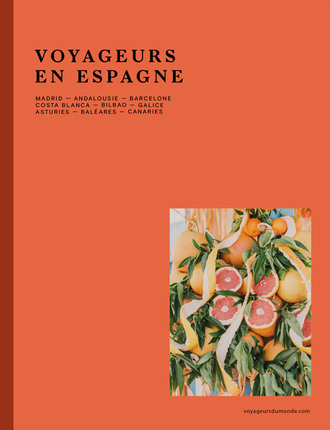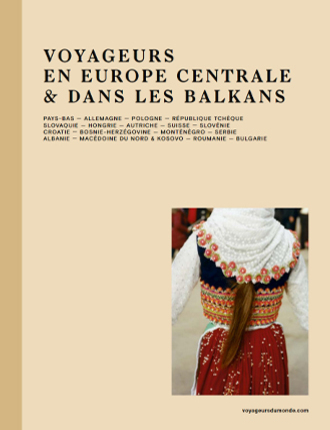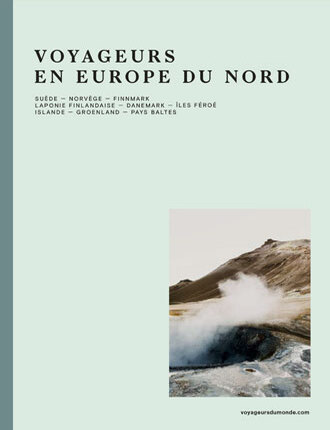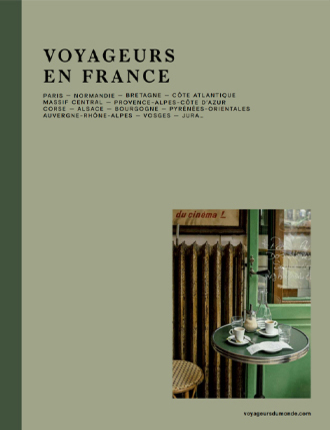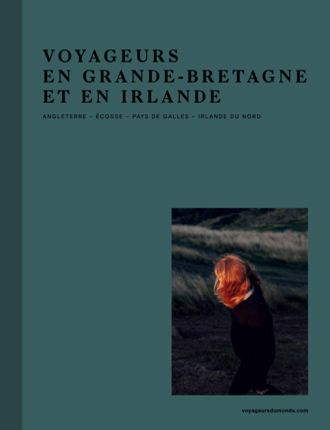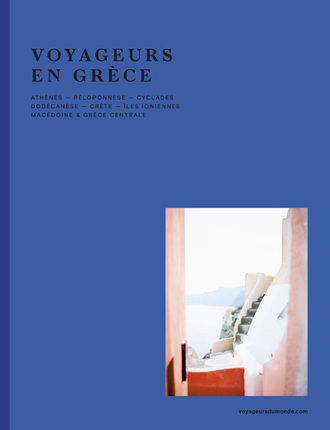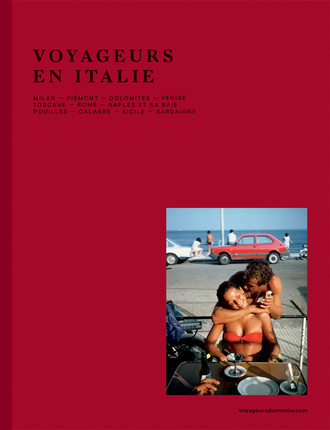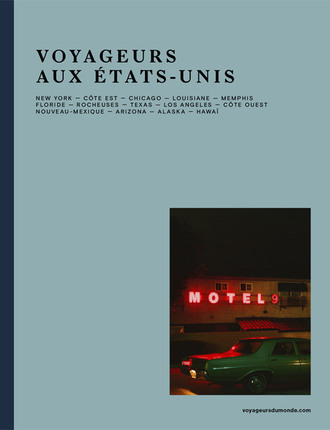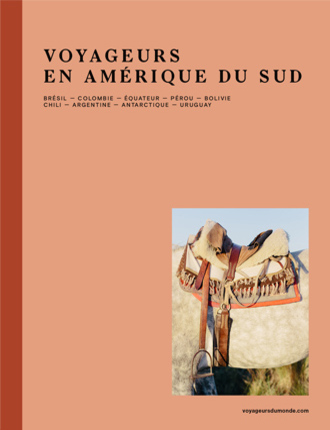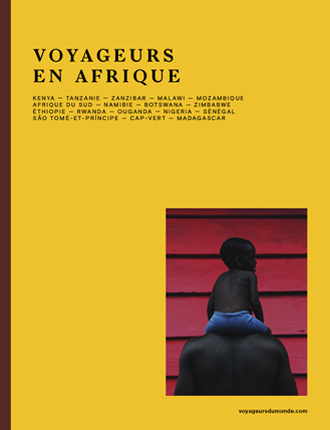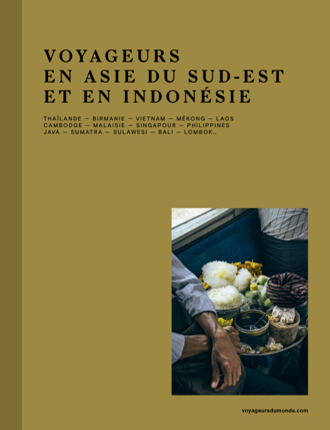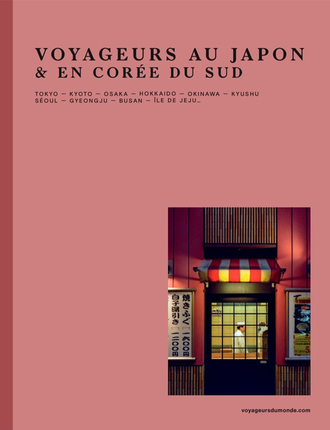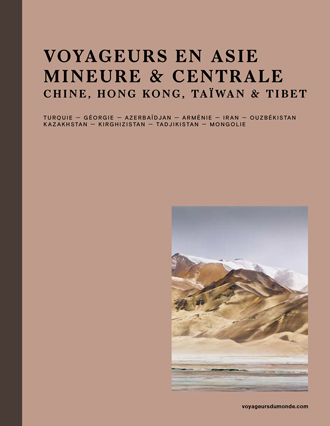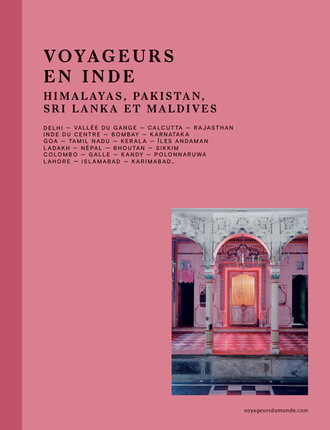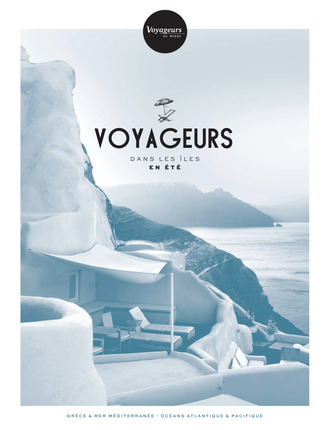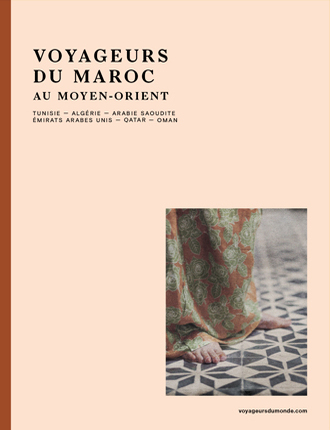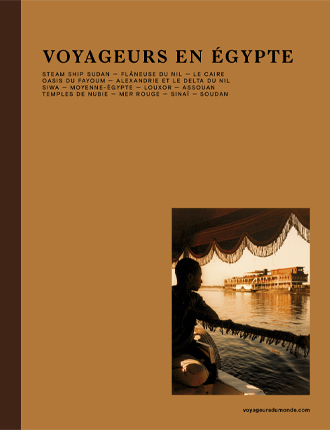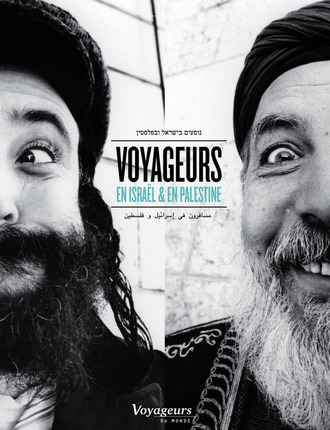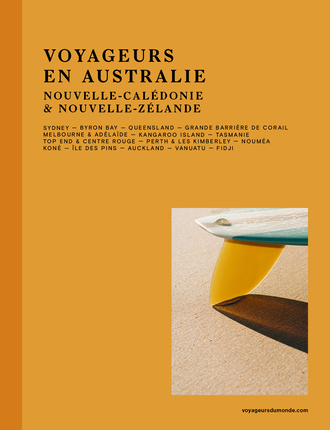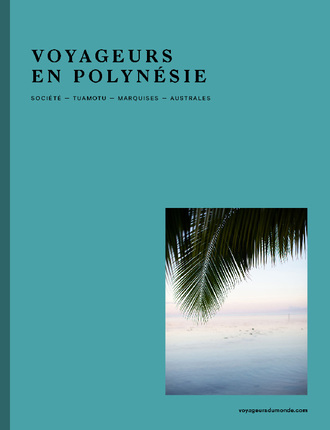Burton, Speke, Livingstone, Stanley : les grands explorateurs britanniques du XIXe siècle. On les imagine de beige vêtus, une boussole dans une main, une plume dans l’autre, fendant des contrées farouches au péril de leur vie. Des pérégrinations qui les amenèrent naturellement jusqu’en Ouganda. Voyage aux sources du Nil – et du rêve.
Explorateurs d'hier...
Europe, 1850. Un mystère immémorial est sur le point d’être levé : où sont enfouies les sources du Nil ? Engagées dans une course contre la montre, les puissances européennes dépêchent leurs délégations en Afrique, bien décidées à ravir la primauté de cette découverte. C’est dans ce contexte que la Royal Geographic Society de Londres finance une expédition menée par les Anglais Richard Francis Burton et John Hanning Speke. Le premier est un explorateur, écrivain, poète, linguiste, ethnologue, escrimeur à la réputation bien établie. Le second, explorateur lui aussi, est censé progresser dans son ombre. Et pourtant…
Les relations entre le duo se sont fortement dégradées lorsque l’opération débarque, en 1858, sur les rives du lac Tanganyika (à cheval entre les actuels Burundi, Congo, Tanzanie et Zambie). Burton est prompt à déclarer le plan d’eau comme étant la source tant recherchée. Speke ayant eu vent d’un autre site, il décide de filer seul en quête de ce dernier. Le 3 août 1858, il atteint un lac qu’il baptise Victoria en l’honneur de sa souveraine – celui-là même qui borde l’actuelle capitale ougandaise, Kampala – et l’identifie comme source du Nil. Les aventuriers étant en désaccord, c’est à qui rejoindra en premier l’Angleterre pour annoncer sa découverte. Speke remporte cette manche. Le doute n’étant pas permis, la Royal Geographic Society finance une nouvelle expédition de John Speke, cette fois en compagnie de James Grant. Ceux-ci retrouvent le lac Victoria le 28 juillet 1862 et confirment par télégramme leur trouvaille.
Richard Burton persistant dans son refus, un débat est fixé au 16 septembre 1864 afin de départager les deux hommes. Toutefois, la veille, Speke perd subitement la vie dans un accident de chasse – d’aucuns prétendront qu’il s’est donné la mort, trop effrayé à l’idée de se mesurer à Burton, réputé pour ses qualités oratoires. Son adversaire récolte tous les lauriers. Une dizaine d’années plus tard, l’expédition menée par Henry Morton Stanley – celui-là même qui retrouva le Dr Livingstone, disparu en quête, lui aussi, des sources du Nil – donne raison au défunt Speke, qui n’est malheureusement plus là pour voir sa réputation restaurée.

Denys Kutsevalov/stock.adobe.com
... et d'aujourd'hui
L’Afrique abrite-t-elle encore ces paysages sauvages et indomptables que les explorateurs peinaient à traverser ? Au gré de leur progression, il fallait tantôt négocier, tantôt se battre pour obtenir droit de passage auprès de dame Nature et des tribus locales. De nos jours, aux quatre coins du continent, les acteurs du tourisme cultivent cette image du camp de brousse d’antan dont les visiteurs apparaissent particulièrement friands. Sous la toile d’une tente blonde, une malle qui n’a jamais rien transporté gît au pied du lit. Plus loin, une lanterne à pétrole rendue superflue par l’existence d’un système d’électricité dernier cri. Le vice va parfois jusqu’à disposer, sur le bureau, en deçà d’une mappemonde, un carnet au cuir vieilli. Un style fabriqué, teinté de nostalgie.
L’Ouganda, pour sa part, ne s’embarrasse que peu de ces artifices. Le vieux Range Rover vert calé au fond d’une grange est las d’attendre son heure et ses propriétaires n’ont pas idée de le rendre acteur d’une mise en scène mélancolique. Revenir en arrière : très peu pour le pays qui souhaite, lui, aller de l’avant. Pour autant, c’est ici que l’on se sent le plus l’âme d’un aventurier. Les panoramas s’érigent, bruts, souvent vierges d’infrastructures. Le Murchison Falls National Park vient tout juste d’être doté d’un axe routier étincelant. Les chutes qui lui ont donné son nom sont tout au plus équipées d’un escalier ourlant la falaise. Dans la forêt de Bwindi, où s’aventurent pourtant chaque jour les rangers, il faut inlassablement tracer sa voie à la machette. Et rares sont ceux qui s’aventurent du côté de la chaîne du Rwenzori, superbement préservée.
Surtout, parce que l’État est bien moins fréquenté que ses voisins, on avale parfois plusieurs dizaines de kilomètres avant de croiser la route de ses congénères, sur la terre ou sur l’eau – y compris en haute saison, et sur les sites les plus populaires. Un isolement qui suffit à se sentir privilégié, sinon pionner. Du secteur d’Ishasha dans le Queen Elizabeth National Park aux forêts d’acacias du lac Mburo, enivré par des paysages désertés, on se laisse donc happer par la beauté d’une terre qui s’offre sans retenue. Et ce, sans avoir à se bercer d’illusions.

Getty Images/iStockphoto
Par
MARION LE DORTZ
Photographie de couverture : Dietmar_/stock.adobe.com