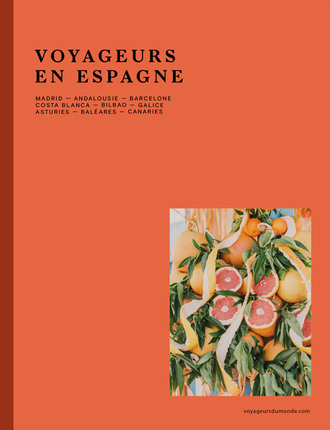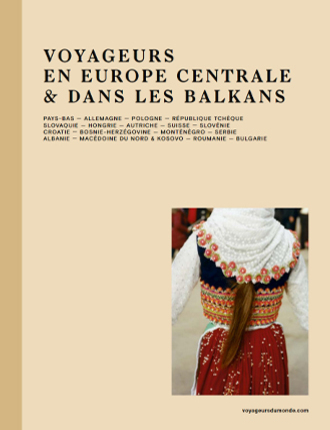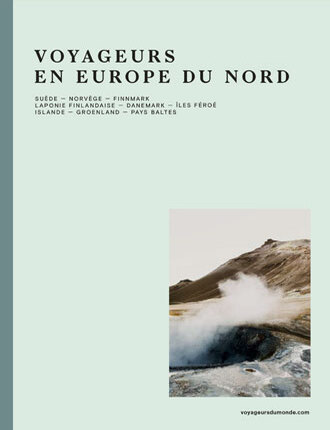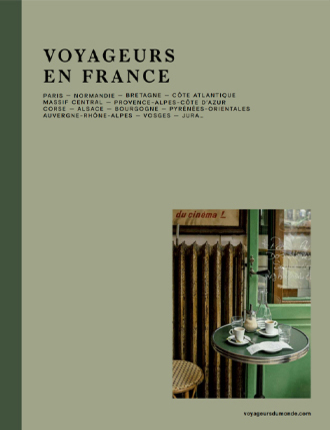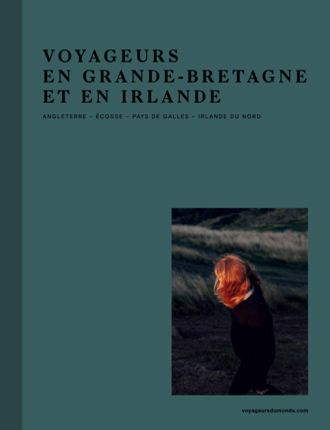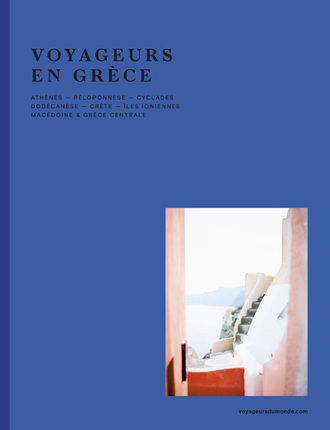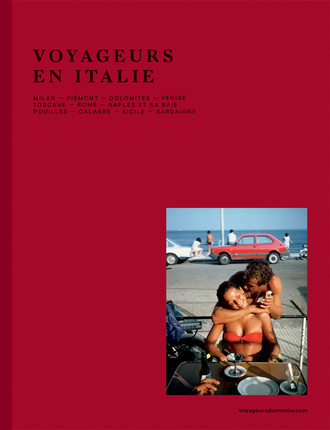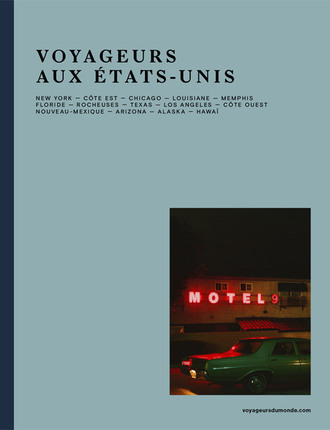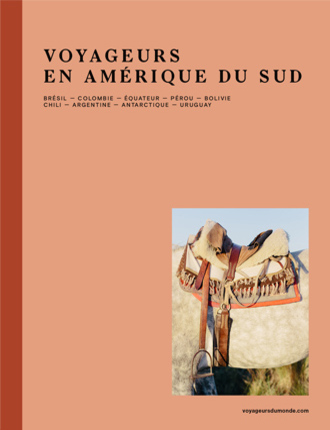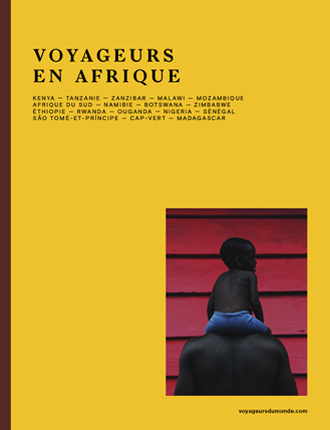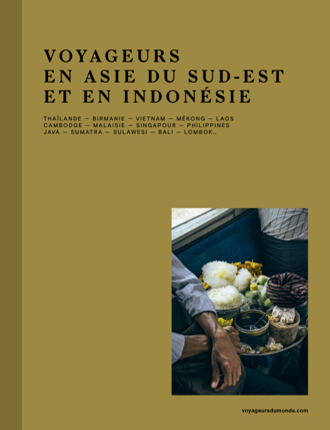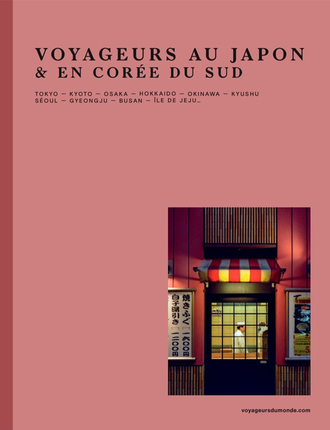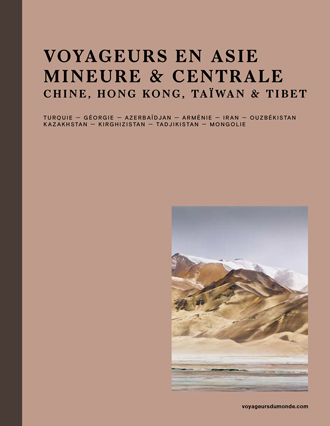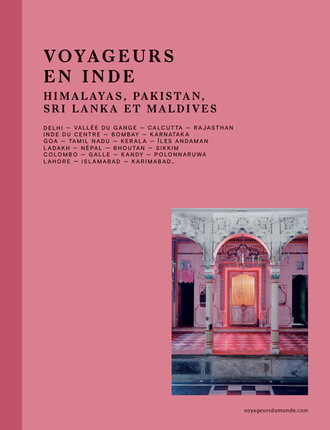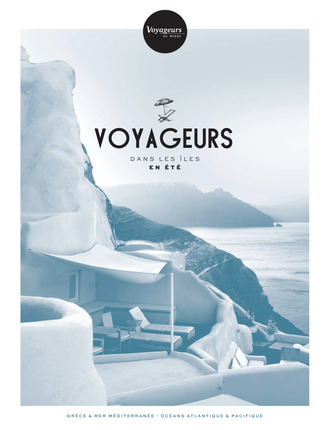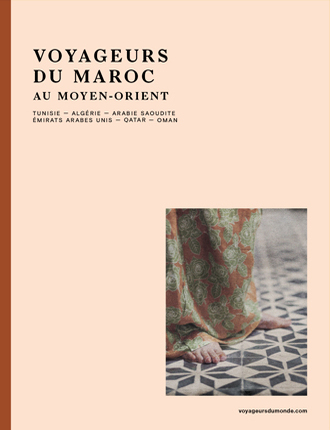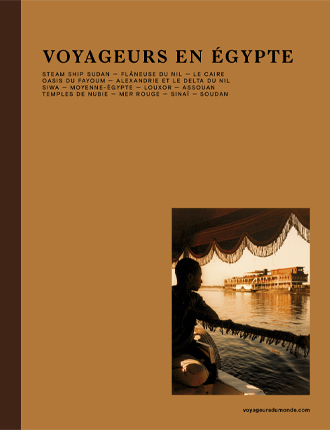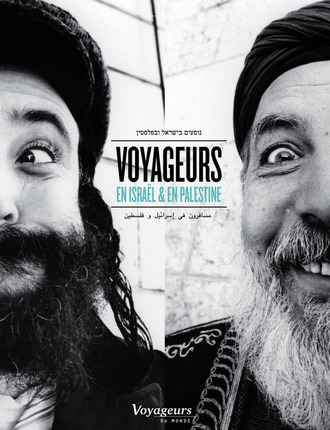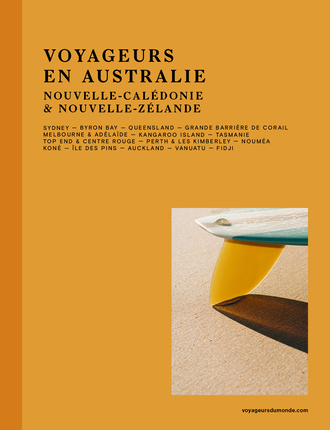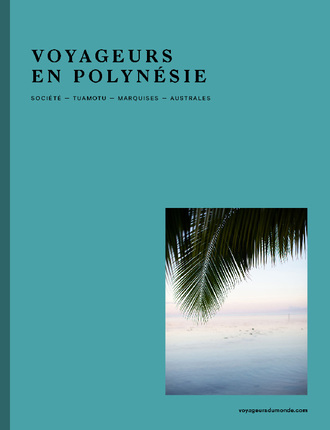Population
129 739 759, en 2025.
Langue officielle
L’espagnol, de facto.
Langues parlées
94% des Mexicains ont l’espagnol pour langue maternelle. Environnement linguistique très homogène. Néanmoins, 6% qui représentent plusieurs millions de personnes, les langues indiennes vivantes sont encore nombreuses. Ainsi le nahuatl, le maya du Yucatán, le tzeltal, le purépecha, le totonaque, le tzotzil, etc. Les critères retenus font varier le nombre de ces idiomes, d’une soixantaine à près de trois cents, mais un consensus les répartit en onze familles. Avec plus d’un million et demi de locuteurs, le nahuatl vient d’abord. Puis ce sont le maya, autour de 800 000, et les langues mixtèques, 480 000. La situation linguistique des Indigenas va de l’usage exclusif de la langue autochtone (certaines régions du Chiapas et de l’Oaxaca) à l’assimilation, en passant divers degrés de bilinguisme. Au point de vue constitutionnel, l’espagnol et les langues indigènes sont toutes des langues nationales. Et il incombe aux différents échelons de la structure d’État de protéger et assurer la promotion, la préservation, le développement et l’utilisation des langues indigènes nationales. Entre principes et nécessités quotidiennes, l’usage louvoie. Par ailleurs, 10% des Mexicains, environ, ont une bonne pratique de l’anglais : frontière nord et sites de contact avec les étrangers. Le français est anecdotique.
Peuples
La population mexicaine est fortement métissée. On l’estime formée à près des deux tiers de mestizos, métis. Les Indigenas étant environ 20%. Et le restant constitué des descendants endogames de colons espagnols. Schématiquement. Les Indiens sont présents dans les États de Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz et Yucatán notamment. Ils sont Nahuas, Mayas yucatèques ou tzeltals, Tzotzils, Mixtèques, Zapotèques, pour les plus nombreux. Ici ou là, leur nombre se monte aux deux-tiers de la population. Les Nord-Américains sont la première communauté immigrée du pays. Retraités beaucoup et télétravailleurs. Les 40 000 mennonites ne pèsent pas sur la démographie, mais ils permettent de souligner le caractère généralement tolérant de la société mexicaine.
Religions
80% des Mexicains sont catholiques. Un catholicisme parfois nuancé de croyances et de pratiques adventices. Le manteau de la Vierge de Guadalupe est large. Les religions précolombiennes ont trouvé dans l’Église (et à ses abords) la possibilité d’une survie plus ou moins cryptique. Le fameux Dia de Muertos peur servir d’illustration. Par ailleurs, depuis le milieu du XXe siècle, émerge le mouvement Mexicayotl, qui entend revivifier le vieux fonds indigène. Comme partout aux Amériques, l’évangélisme est dynamique. Les adventistes du septième jour, l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, les témoins de Jehova, La Luz del Mundo notamment font florès. Interdit du XVIe au XIXe siècle, le judaïsme a un regain, consécutif aux tensions et persécutions en Europe et dans le bassin méditerranéen. À cela, s’ajoutent quelques milliers de musulmans et 100 000 bouddhistes environ. La liberté religieuse est garantie par la constitution.
Fête nationale
16 septembre : Grito de Dolores, 1810.
Calendrier des fêtes
1er janvier : jour de l’an.
5 février : commémoration de la Constitution de 1917.
En mars ou avril : Pâques.
17 mars : commémoration de Benito Juarez.
1er mai : fête du travail.
16 septembre : fête nationale.
2 novembre : jour des morts.
20 novembre : jour de la Révolution.
12 décembre : Notre-Dame de Guadalupe.
25 décembre : Noël.
Politique
Les Estados Unidos Mexicanos sont une République fédérant 32 États. Le fonctionnement institutionnel est réglé par la constitution de 1917, plusieurs fois amendée. Le président (élu au suffrage universel direct pour un unique mandat de 6 ans) est chef de l’exécutif ; il oriente la politique fédérale, compose le gouvernement, nomme de nombreux hauts fonctionnaires, peut émettre des décrets dans les domaines économique et financier. Le parlement, Congreso de la Union, est bicaméral. Le Sénat, chambre haute, est composé de 128 sénateurs (mandat de 6 ans) ; la Chambre des députés, chambre basse, compte 300 membres élus par les circonscriptions électorales et 200, élus à la proportionnelle à travers tout le pays (ce pour faciliter l’accès de petites formations à la Chambre). Le Congrès est dépositaire du pouvoir législatif. Les États fédérés jouissent d’une large autonomie, limitée par les prérogatives de l’État fédéral (en matière de politique étrangère, par exemple). Ils disposent d’un gouverneur élu, d’un parlement et d’un Tribunal de justice supérieur. Comme telles, les entités fédératives sont représentées au Sénat. Au niveau fédéral, l’édifice judiciaire est coiffé par la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Les juges y sont nommés pour quinze ans sur proposition du président de la République, validée par le Sénat.
Histoire
Civilisation-mère du Mexique, les Olmèques, hommes du caoutchouc, occupent les basses terres du sud entre les 3e et 1er millénaires avant notre ère. Ils cultivent le maïs, les haricots, les courges, la patate douce. San Lorenzo, dans l’État de Veracruz, et La Venta, dans celui de Tabasco, sont de grands centres rituels urbanisés. Les Olmèques rendaient un culte au jaguar et ont laissé des chefs sculptés monumentaux, dont le sens est débattu. Puis viennent, au cours du 1er millénaire de notre ère, les Mayas (méridionaux encore), Teotihuacan (région de Mexico), les Zapotèques (Oaxaca), les Totonaques d’El Tajin (Veracruz), les Huaxtèques (sur le rio Panuco et le golfe du Mexique). À Teotihuacan, on doit le culte du serpent à plumes, Quetzalcoatl. Et un premier cosmopolitisme mésoaméricain. Les Zapotèques ont repris la fondation olmèque de Monte Alban, dont ils ont fait leur chef-lieu. Les Mayas pour leur part ont édifié des cités-États en grand nombre ; les plus importantes étant Chichén Itzá et Uxmal, au Yucatán, Palenque et Bonampak-Yaxchilan, au Chiapas, et Tikal, dans l’actuel Guatemala. Eux aussi adoraient le serpent à plume, sous le nom de Kukulcan. Un clergé partageait le pouvoir avec l’aristocratie, sacrifiait aux dieux, en recueillait les avis. Les liens familiaux corrigeaient les effets clivants d’une hiérarchie sociale appuyée. Grands constructeurs ignorant la clé de voûte et agriculteurs avisés ignorant la roue et le fer. Les Espagnols ont hélas détruit leurs livres. Ils avaient conçu le zéro et développé mathématiques et astronomie. Un peu chancelants au Xe siècle, l’arrivée des Toltèques – installés à Tula, dans la Valle del Mezquital – qui apportaient la métallurgie, leur rendit de la vigueur pour deux siècles. Chichén Itzá témoigne encore de la contribution toltèque.
Au cours de la première moitié du XIVe siècle, des gens du nord, les Aztèques, viennent sur l’Altiplano et fondent Tenochtitlan, dans la vallée de l’Anahuac. Ces chasseurs militarisés ne prennent pas de gants pour étendre leur domination. Huitizilopochtli, dieu du soleil et de la guerre, réclame du sang : les peuples vaincus fournissent aux libations. Les sacrifices se multiplient. Néanmoins, ces brutaux sont également des administrateurs précis et des ingénieurs ingénieux ; ce dont témoigne leur capitale, qui comptera 200 000 habitants à l’arrivée des Espagnols. L’organisation sociale, politique et religieuse de l’Empire est complexe et serrée ; elle en assure efficacement la supervision. Lorsque les conquistadores débarquent, la maison est bien tenue. En 1519 donc Hernan Cortés prend pied et fonde la Villa Rica de la Vera Cruz (Veracruz). Il parvient ensuite sans trop d’encombre à Tenochtitlan, où il s’installe avec la bénédiction de l’empereur Moctezuma II. Mais on n’est pas encore en pays conquis et l’avidité sans scrupule des conquistadores, leurs agressions contre la société traditionnelle dressent contre eux les Aztèques. Dans la nuit du 29 au 30 juin 1520, les Espagnols, chargés d’or, tentent de fuir la ville ; au prix de lourdes pertes, une partie d’entre eux y parvient. C’est la Noche triste. Cortés, mettant à profit l’esprit de revanche des populations indigènes soumises à l’Empire, prendra Tenochtitlan l’année suivante et la rasera en partie. Sur ses ruines, on édifiera Mexico. En 1535, le pays devient une vice-royauté, la Nouvelle-Espagne. La culture indienne est mise sous l’éteignoir. Maladies, massacres, mauvais traitements, 70% des indiens disparaissent pendant les décennies suivantes.
La Nueva Espana est sur les rails. Elle s’étendra à toute l’Amérique centrale et, vers le nord, jusque dans les actuels États-Unis : Californie, Texas, Nouveau Mexique, Arizona. Relais essentiel de l’impérialisme espagnol, elle aura la main jusque dans les audiencias de Saint-Domingue et de Manille. Au sud, son influence se verra limitée par l’instauration de la vice-royauté du Pérou. Le système de l’encomienda, concessions accordées par la Couronne, met la population autochtone à la disposition des colons. L’or et l’argent des mines mexicaines changent la donne sur les marchés européens et asiatiques. L’échange colombien redessine la carte des organismes vivants. Sur place, le pouvoir est déposé entre les mains d’une petite population de Peninsulares, Espagnols nés en Espagne. Cependant, la catégorie la plus dynamique est certainement celle des créoles, nés sur place. Les indios sont encore la moitié de la population et les métis ont un statut aussi détaillé qu’ambigu. Dans cette société ultramarine, l’Église est centrale. Solidaire de la colonie, elle sait aussi en critiquer les mécomptes et les aveuglements, ainsi que l’illustre la belle figure du dominicain Bartholomé de las Casas. Franciscains, dominicains et augustins se sont particulièrement illustrés. Si l’évangélisation a tiré un trait sur maints aspects de la culture précolombienne, sa mise en œuvre a aussi contribué à en sauver d’autres. La Real y Pontificia Universidad de México est fondée en 1553.
Assez rapidement, une société précipite, dont les intérêts propres se précisent. Au début du XIXe siècle, elle est mûre pour l’idée nationale. Le 15 septembre 1810, c’est un ecclésiastique, Miguel Hidalgo y Costilla, qui lance un premier mouvement en ce sens. Vite réprimé. Les Américains soutiennent leur cause par les voies qui leur sont offertes : politiques et militaires. Devant l’intransigeance de Ferdinand VII, les armes décident. Le 24 août 1821, Agustín de Iturbide, leader indépendantiste de Nouvelle-Espagne, obtient par le traité de Cordoba l’indépendance du Mexique. Ce sera d’abord un Empire. Aboli au profit de la République dès 1824. En 1823, le Guatemala et le Honduras ont entrepris de voler de leurs propres ailes. Gros temps pour le général Santa Anna – 1794-1876 – qui s’empare du gouvernail d’un pays toujours au bord de la mutinerie. En 1848, les États-Unis annexent le Texas, le Nouveau-Mexique et la Californie. Plus tard, don Diego de la Vega, Zorro, et Davy Crockett, Alamo, se chargeront de justifier tout cela. En 1862, la guerre civile entre libéraux et conservateurs, la politique nationaliste du président libéral Benito Juarez, la suspension du paiement de la dette extérieure déclenchent une intervention étrangère. Notamment française (soutenue par les conservateurs mexicains). Napoléon III, qui espère contrebalancer les USA, se lance dans une aventure au final assez piteuse, dont le malheureux archiduc Maximilien d’Autriche paiera les pots cassés. Et où la légion étrangère trouvera une légende : Camerone. Pendant cinq ans, le Second Empire mexicain est une créature du Second Empire français. En 1867, Juarez, qui n’avait cessé de revendiquer sa légitimité, revient au pouvoir. La politique libérale tend à laïciser et industrialiser le pays.
De 1876 à 1911, la dictature de Porfirio Diaz – 1830-1915 – associe développement et inégalités sociales. Ces dernières emportent le régime et sont la source de dix ans d’une nouvelle guerre civile, la Revolucion mexicana, où s’illustrent notamment Emiliano Zapata et Pancho Villa. Décennie de violences, qui voit pourtant en 1917 promulguer une nouvelle constitution. La quatrième depuis 1824. Pour n’être plus tout à fait la foire d’empoigne, les années 20 n’en sont pas moins houleuses. Entre 1926 et 1929, les morts de la guerre des Cristeros – Viva Cristo Rey ! – se comptent par dizaines de milliers. Le rejet de la constitution s’alimente, à contremploi, de la promotion du dogme de la royauté universelle du Christ par Pie XI (encyclique Quas primas, 1925). L’Église mexicaine sort durablement affaiblie de la crise. À partir de 1934 cependant, Lazaro Cardenas, appliquant le programme du Parti national révolutionnaire – PNR, fondé en vingt-neuf et futur PRI, Parti révolutionnaire institutionnel – mène à bien la réforme agraire et nationalise les pétroles, 1938. La société est stabilisée et l’économie relancée. À la fin de la guerre d’Espagne, de nombreux républicains gagnent le Mexique. Les USA ont mis le pays sous embargo à la suite de la nationalisation des sociétés pétrolières ; néanmoins, après Pearl Harbour, on trouve des arrangements et le Mexique soutient l’effort de guerre yankee. Il devient membre de l’ONU en 1945. L’essor économique de l’après-guerre est brutalement remis en cause par le choc pétrolier de 1973. C’est la récession. Enrayée par la découverte trois ans plus tard d’importants gisements d’hydrocarbures. C’est la relance. Laquelle permet d’engager de profondes réformes sociales. Suivent jusqu’en 1994 douze ans de rigueur et de privatisations, qui se soldent par une grave crise économique. Le peso perdant la moitié de sa valeur. Cette année-là cependant, le Mexique rejoint les USA et le Canada dans le Nafta (North American Free Trade Agreement). Apparaît alors au Chiapas l’Armée de libération nationale zapatiste ou EZLN, pour Ejercito zapatista de liberacion nacional. Elle est dirigée par le Subcomandante Marcos et porte les revendications culturelles et sociales des indiens. Alors que l’appui de l’administration Clinton contribue à la remise en route de l’économie, le conflit du Chiapas se durcit. Des accords sont signés. Les accords sont violés.
En 2000, le démocrate-chrétien Vicente Fox met fin à 71 ans de pouvoir PRI. Le nouveau président s’engage à réformer l’État, combattre la corruption et favoriser la croissance, afin d’enrayer la pauvreté et la violence. Programme ambitieux et vertueux dont la situation du pays complique la réalisation. Sa longue frontière avec les États-Unis en fait le point chaud de la crise migratoire des années 2010. Parallèlement, la guerre fait rage entre les cartels de la drogue, le Mexique servant de base logistique pour le marché nord-américain. Les tensions qui résultent de ces facteurs ne facilitent pas – c’est le moins qu’on puisse dire – la mise en œuvre de réformes. À l’égard des migrations, l’attitude pragmatique et diplomatique des autorités mexicaines se heurte à une certaine versatilité US (surtout due à l’instrumentalisation politique de ces questions). Le narcotrafic challenge durement la légitimité de l’État. En dépit d’importantes difficultés, le pays tient. Et assume sa position de pont entre les deux Amériques.
Personnalités
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 1474-1548. Selon l’Église catholique, qui l’a canonisé en 2002, cet indien Nahua, auquel la Vierge est apparue en 1531, est à l’origine du grand culte marial américain : c’est sur sa tilpa qu’est apparue l’image de Notre-Dame de Guadalupe, aujourd’hui exposée dans la basilique Santa Maria de Guadalupe à Mexico. Le pape Jean-Paul II a fait de Juan Diego le protecteur des peuples autochtones.
La Malinche, 1ère moitié du XVIe siècle. En faisant cadeau de Malintzin à Hernan Cortés, le cacique maya Taabscob lui offrait sans le savoir la clé de l’empire aztèque. Les talents linguistiques et l’intelligence vive de la jeune Nahua firent d’elle mieux qu’une maîtresse : un special advisor du conquistador. Lui permettant de tirer profit des rancœurs accumulées contre Tenochtitlan. Une figure de l’ambigu mexicain.
Juana Ines de la Cruz, 1651-1695. Dans la société mexicaine du XVIIe siècle, lorsqu’on était femme, intellectuelle et désargentée, on n’avait qu’un choix à faire : l’ordre religieux qui offrirait les meilleures conditions. Pour Juana Inés de Asbaje y Ramirez de Santillana, ce furent les Hiéronymites. Elle devint sor Juana Inés de la Cruz et les lettres espagnoles y gagnèrent une auteure à laquelle elles ne s’attendaient pas.
Octavio Paz, 1914-1998. Les services diplomatiques ont occupé quelques poètes éminents, dont celui-ci, l’un des plus grands de l’espagnol moderne. Son gagne-pain l’expédiant aux quatre vents, il a donné à son Mexique natal des ailes universelles et défendu, où et quand il le fallait, les libertés civiles et les exigences de la culture humaniste. Il ne pouvait décemment manquer au palmarès du prix Nobel : littérature en 1990.
Diego Rivera, 1886-1957. Ce n’est pas seulement le mari de Frida Kahlo. D’ailleurs, il ne fut pas exemplaire à cet égard. Fresquiste considérable, Diego Rivera aura montré que des convictions communistes n’étaient pas incompatibles avec un tempérament artistique intègre. Ni avec la célébration du passé préhispanique. On verra à cet égard l’immense Épopée du peuple mexicain, au Palacio Nacional de Mexico.
Rodolfo Guzman Huerta, El Santo, 1917-1984. On ne s’avise pas assez que la lucha libre classique n’est autre chose que la lutte du bien et du mal. À ce titre, El Santo, catcheur tecnico et icône sud-américaine, fut un paladin du ring. Ses exploits contre les rudos de tous poils ont été diffusés hors de l’arène aussi bien par le cinéma que par la bande dessinée. Parmi les emblèmes populaires de la justice, il y eut son masque blanc.
Rodolfo Rodriguez, El Pana, 1952-2016. Le Mexique est l’autre pays de la corrida. La Plaza de Toros Monumental de Ciudad de Mexico est la plus grande du monde. Quoi qu’on pense de l’art de toréer, c’est un fait culturel. Et El Pana fut une figure excentrique et pittoresque des courses mexicaines. Il ne déposait jamais son cigare, surtout pas devant le toro. Il est mort en scène, les cervicales brisées par un coup de corne.
Claudia Sheinbaum, née en 1962. Sans doute, les Mexicains sont-ils un peu macho. Ils ont cependant confié la direction des opérations à une femme. Et au Mexique le président, la présidente, n’est pas là pour inaugurer les chrysanthèmes. Claudia Sheinbaum, climatologue reconnue, corédactrice du cinquième rapport du GIEC et membre du Movimiento Regeneracion Nacional à la carrure pour le poste.
Macedonia Blas Flores, née en 1958. Cette dame Otomi a travaillé longtemps, dans le plus parfait anonymat, à la défense et promotion des femmes de sa communauté de l’État central du Querétaro. Les circonstances et la qualité de son engagement ont attiré l’attention sur elle. Sans dévier de sa ligne, elle profite de cette notoriété pour intensifier son action, notamment contre les violences dont sont victimes les femmes Otomi.
Paola Espinosa, née en 1986 à La Paz, Baja California Sur. Peut-être est-ce une métaphore mexicaine : Paola Espinosa a l’art de tomber de haut, sans dommage. C’est une plongeuse de classe mondiale, qui a décroché l’argent olympique (Londres 2012, plongeon synchronisé à 10 mètres, avec Alejandra Orozco) et l’or mondial (Rome 2009, plongeon à 10 mètres). Plouf. Plouf.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
En ce qui concerne le personnel local – serveurs, porteurs, etc. – les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.
Au restaurant, vous ne serez ni surpris, ni inquiété, par la grande rapidité du service : au Mexique, c’est un gage de qualité.
Soyez indulgents envers certaines attitudes à caractère machiste. Le machismo est profondément inscrit dans la mentalité mexicaine. Qu’il s’agisse de boire, de défier des chevaux sauvages dans les rodéos (charreadas), qu’il s’agisse encore de l’importance de la tauromachie, l’homme mexicain manifeste – directement ou par procuration – son orgueil d’être un homme. Les Mexicaines font avec. Elles n’en pensent pas moins. Et prennent pied dans les anciennes chasses gardées.
Les Mexicains s’adonnent avec délice à la platica, la conversation. Néanmoins, on évitera les sujets polémiques. Dont, en premier lieu, le gouvernement.
Rien ne sert de s’énerver. En cas de problème, on optera toujours pour la gentillesse, la courtoisie et le calme.
Le Mexique n’est pas le pays de la ponctualité. Les horaires y sont simplement indicatifs et on est rarement à l’heure à un rendez-vous.
Cuisine
La cuisine traditionnelle mexicaine, expression spécialement ritualisée et intègre d’une société et de sa culture, est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité. On en repère sans peine l’assise : la triade maïs-haricots-piment. Préhispanique et toujours d’actualité. Bien entendu, cela s’agrémente, depuis toujours, de diverses manières. La nixtamalisation, cuisson des grains de maïs à l’eau de chaux (ou cendrée), afin d’en faciliter la préparation, est un procédé très ancien. À ces trois ingrédients, on doit ajouter des cactus ; le nopal d’abord – le figuier de Barbarie – pour ses fruits mais également ses raquettes. Les Espagnols ont introduit les viandes d’élevage et le fromage, le blé, le riz. Lesquels ont trouvé place sur les foyers, sans toutefois remplacer ce qui s’y trouvait déjà. Compléments, en somme. Au cours de l’histoire, d’autres influences ont joué. Avant d’évoquer quelques préparations caractéristiques de différents États, il faut indiquer que le chili con carne n’appartient pas au cookbook mexicain. Son caractère est nettement US, en dépit d’une inspiration évidente. Propice à l’élevage et à la culture du blé, le Nord est nettement espagnol. Les viandes se grillent et les tortillas sont de froment. C’est aussi la région fromagère. Les nopalitos, dés de nopal, viennent des profondeurs de l’histoire. Ville-creuset, Mexico a pour cuisine les cuisines du pays. Le Nord a fourni le cabrito al pastor, par exemple, le chevreau cuit à la braise. Et l’Hidalgo la barbacoa de borrego, mouton cuit à l’étouffée dans un four enterré. Le Michoacan procurant les carnitas, cochon braisé. La cuisine d’Oaxaca est restée proche de l’origine précolombienne : maïs, haricots, piments et poisson, le long du littoral. Autour du cacao, on décline le mole. Le Pacifique met poissons et fruits de mer sur la table des États occidentaux. La nixtamalisation intervient dans la préparation du pozole, potée de maïs et de porc (un indice supplémentaire de la grande proximité de l’homme et du cochon). Lorsqu’on va vers le sud et l’est, les fruits tiennent une place de plus en plus importante dans la cuisine. Au Veracruz, les Antilles se font sentir. Effluves français et africains. Ici, le riz a fait reculer le maïs. La tradition maya est encore sensible au Yucatán. Cochinita pibil est assez emblématique : porc mariné au roucou, enveloppé de feuilles de bananier et cuit au piib, le four enterré. Longtemps, on a préparé ainsi des cochons entiers. Le cerdo pelon en particulier, le cochon créole du Mexique, descendant direct des animaux apportés par les Espagnols. La vocation rituelle et festive de ce plat est marquée. En période précoloniale, on mettait à cuire du cerf, du pécari, du dindon. Un peu partout, le goret et le poulet se sont substitués au gibier. Évolution décisive à plus d’un titre. Un plat national ? Disons, le mole poblano. C’est la version Puebla du mole. Celui-ci est une sauce épaisse, dans laquelle entrent cacao, piment, cacahuète, tomate, etc. Etc. pouvant monter à une centaine d’ingrédients. Ce qui est suggérer la variété possible. Le plat national est donc, plus qu’une recette canonique, une espèce de principe culinaire. Le mole poblano se verse volontiers sur du dindon domestique ou du poulet. Ou des enchiladas, qui sont alors enmoladas.
Street food : l’antojito, la petite faim, conduit les Mexicains à une multitude de stands, d’édicules, d’échoppes, de food trucks. Les tacos étant la façon la plus commune de combler la fringale. Un taco, c’est une tortilla, sur laquelle on met tout ce qu’il est possible d’absorber ainsi. La gordita est une tortilla de maïs fourrée, comme un chausson. De chicharron, par exemple. Le chicharron prend la forme de gratons ou de couenne de porc frite. L’empalme est une combinaison de deux tortillas garnies de lard et de frijoles refritos, typique du Nuevo Leon. Les esquites sont des grains de maïs servis dans un gobelet (elotes lorsqu’ils sont sur l’épi). Très répandues, mais fierté d’Oaxaca, les tlayudas sont de grandes tortillas sur lesquelles sont déposés purée de haricots frite et compléments variés. Les tamales sont cuits à la vapeur dans des feuilles de maïs. Les tortas sont des pains garnis ; les cemitas, d’autres pains garnis. Al pastor fournit à toutes ces garnitures. C’est la version mexicaine du kebab : viande marinée, cuite en toupie sur un grill vertical, mais viande de porc. Le Sonoran hot dog est un jeune trentenaire, qui a déjà conquis l’Arizona. Et on ne fait qu’effleurer la question !
Boissons
L’eau du robinet n’est pas potable. On boira donc de l’eau minérale en bouteille (capsulée) : agua sola pour l’eau plate, agua mineral pour l’eau gazeuse. Ou de la bière, généralement blonde et légère. Ou des sodas, les refrescos, qui contribuent vaillamment à faire de l’obésité un vrai problème de santé publique. À ceux-ci, on préfèrera sans doute les jus de fruit frais, bien souvent délicieux. Les infusions d’hibiscus ou de tamarin, sont à ne pas négliger. Ici, horchata n’est pas une boisson obtenue à partir du tubercule de souchet, comme en Espagne, mais de riz.
La tequila et le mezcal sont les alcools-phares. La première se distille à partir de l’aguamiel de l’agave bleu, Agave tequilana. La meilleure est 100% agave ; on peut néanmoins descendre jusqu’à 51% et rester tequila. La 100% est bue telle quelle. Les autres entrent dans de nombreux cocktails. Blanco ou plata, la tequila est sortie d’alambic ; mais on a pu aussi la conserver dans des barriques de chêne – 3 ans minimum pour la qualité Extra Anero – où elle prend une teinte ambrée et une saveur plus complexe. La production du mezcal est similaire à celle de la tequila, mais plusieurs variétés d’agave, maguey, sont possibles. En revanche, l’alcool, pour avoir droit à l’appellation mezcal, est distillé à partir d’agave exclusivement. La saveur tient aux variétés de maguey et au bois utilisé pour cuire le cœur de la plante. Le mezcal est un personnage à part entière du roman de l’écrivain britannique Malcolm Lowry, Under the Volcano. Avant l’introduction de la distillation par les Espagnols, au XVIIe siècle, l’alcool d’agave était le pulque, issu de la fermentation naturelle de la sève. Ce breuvage précolombien, qui titre entre 6° et 8°, est toujours consommé, en dépit de la concurrence féroce de la bière. La viticulture est d’origine espagnole. Elle eut un si beau démarrage que les vignerons ibériques en prirent ombrage. Elle est alors réservée aux religieux, pour des raisons liturgiques. Aujourd’hui le vin mexicain existe, discrètement.
Dans l’ancien monde mésoaméricain, le cacao a eu lui aussi partie liée avec la religion, la consommation du kakaw étant souvent rituelle. Et thérapeutique. Les Mayas l’associaient au dieu économique Ek Chuah et les Aztèques à Xochiquetzal, déesse de la fertilité. On a des traces d’utilisation pré-Olmèque. Cette boisson a perdu de son amertume depuis ces époques reculées. Et le maïs peut être bu. Sous forme d’atole, une boisson chaude à base d’amidon (au petit déjeuner, elle accompagne les tamales), par exemple, ou de tejuino, boisson froide fabriquée à partir de grains de maïs germés et de sirop de canne.