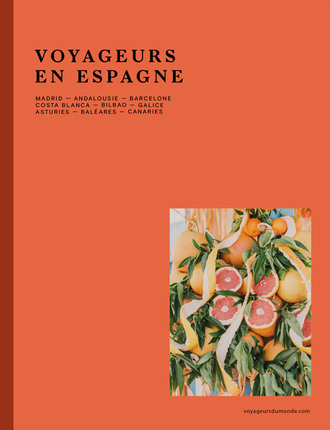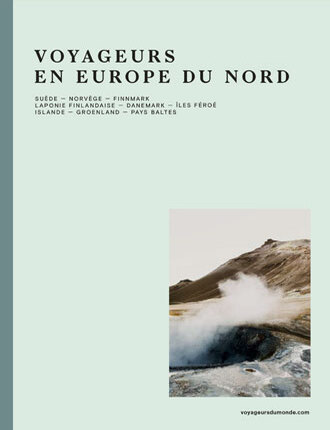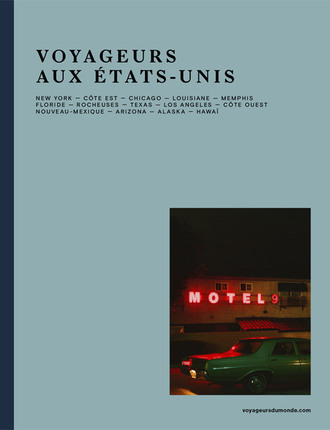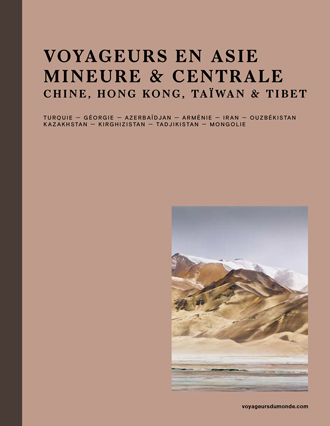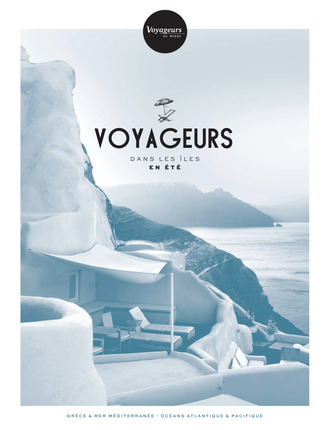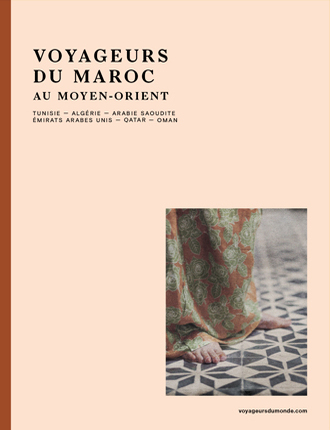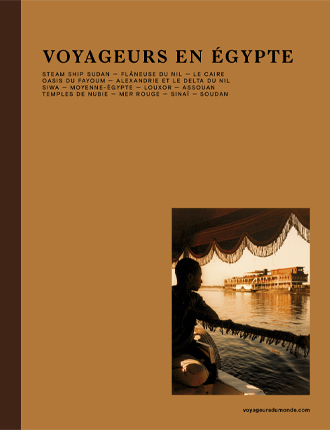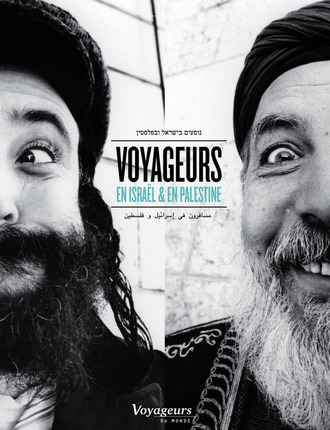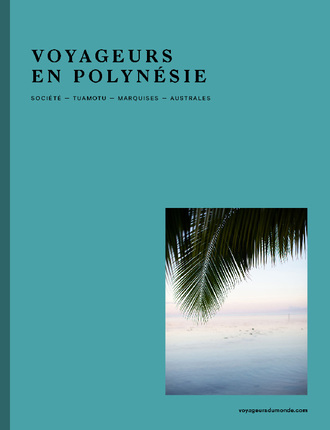Mystérieuses îles de basalte posées sur l’équateur, São Tomé et Príncipe affichent une nature extravagante. Ancienne colonie portugaise, le plus petit des États africains, longtemps premier producteur mondial de cacao, se tourne aujourd’hui vers le voyage écoresponsable.
Le “milieu du monde” est chaud et moite. Il pleut sur São Tomé, la petite île qui doit cette appellation prestigieuse au fait d’être posée au croisement de l’équateur et du méridien de Greenwich, dans le golfe de Guinée. Un voile lumineux brouille la silhouette des cargos à l’ancre dans la baie que soulignent les toits de tuiles d’une capitale aux airs de bourgade tropicale. Une averse drue rince les murs colorés des bâtisses coloniales et vide les rues en un instant. Les petites motos chinoises sont massées devant le marché couvert où les badauds se sont abrités, dans les odeurs mêlées de poissons et de fruits. “Chuva homem”, “pluie d’homme”, dit-on de cette radée qui “va fort mais ne dure pas”. Puis, après une éclaircie éclatante, une bruine tiède s’installe que chacun ignore pour vaquer en robe ou t-shirt : “chuva mulher”, “pluie de femme” qui, malgré sa douceur, est toujours sur votre dos…

Les lycéens en uniforme grège et bleu se croisent sur la Marginal, l’avenue qui longe la baie derrière sa balustrade blanche effondrée par endroits. Les uns reviennent des cours, les autres y vont faute de salles de classe et d’enseignants en nombre suffisant. En revanche, les petits revendeurs de la compagnie de téléphonie mobile sont à chaque coin de rue derrière leurs banques bleu-ciel. L’archipel de São Tomé-et-Príncipe, l’un des pays les plus pauvres du globe, n’échappe pas au progrès pas plus qu’aux bruits de la modernité mondialisée : les antennes paraboliques s’accrochent aux balcons de la capitale comme aux cabanes des campagnes perchées sur leurs pilotis. Mais les femmes vont toujours à la rivière pour laver le linge, de l’eau jusqu’à mi-cuisses, pendant que les gamins barbotent et que les vêtements sèchent sur l’herbe des rives. Les filles vont chercher l’eau aux fontaines de faïence blanche, toutes les mêmes de village en hameau. Les gamins marchent sur le chemin de l’école, une feuille de bananier en guise de parapluie. Les hommes arpentent les sentiers jusqu’à l’océan pour pêcher, s’enfoncent dans la forêt pour cueillir les noix de coco ou les fruits à pain – Un homme qui ne sait pas grimper à l’arbre n’est pas un Santoméen, peut-être même pas un homme…”, glisse en riant notre accompagnateur.

Offrande des pluies tropicales, la nature est généreuse dans “les îles du milieu du monde”. C’est peut-être pour cela que les jours semblent y couler entre fatalisme et patience, au rythme que décrit si bien l’expression “léve léve”, quelque chose comme “doucement-doucement”. Ce temps différent nourrit le sentiment de lointain autant monde, souvenir de volcans éteints qui serrent leurs flancs de forêt vierge pour dessiner une silhouette d’île mystérieuse. Lorsque les nuages lourds s’y accrochent et que l’étrange pico Cão Grande (pic du Grand Chien), dressé comme un phallus, se perd dans la brume, São Tomé prend des airs de contrée fantastique où un King Kong amoureux rêverait d’enlacer Jessica Lange.
Passé colonial, roças et renouveau
Si l’on ne sait pas le temps qu’il faisait lorsque les Portugais abordèrent les rivages déserts, en 1470 ou 1471 – “Les textes ne sont pas clairs, il se pourrait que d’autres, Phéniciens ou Arabes, les aient vus avant”, regrette l’historien Fernando d’Alva –, les jours des découvertes en revanche sont précis. Les îles furent baptisées selon le calendrier chrétien : le 21 décembre pour São Tomé (saint Thomas), le 17 janvier pour Santo António qui deviendra Príncipe, l’île du prince. Fernando d’Alva survole les siècles entre café et cigarettes à la terrasse de l’hôtel Omali qui regarde la baie. Comme chaque dimanche, la plage bruisse de familles rassemblées pour le pique-nique et la baignade, les couleurs de peau déclinent la palette des bruns, reflets des métissages : “Les Portugais ont d’abord encouragé les unions avec les femmes noires afin de créer une race suffisamment costaude pour ces latitudes. Les enfants qui en naissaient furent affranchis, certains devenant trafiquants d’esclaves pour les colonies d’Amérique”, précise l’universitaire qui sait que l’histoire des “forros”, les “fils de la terre” natifs de l’île, ne s’est pas écrite en noir et blanc. De l’autre côté de la baie, une église se souvient de deux mille enfants issus de familles juives expulsées d’Espagne, déportées ici en 1495 pour être converties au message d’amour catholique. Tout près, la forteresse Saint-Sébastien, devenue musée national, raconte l’exploitation des hommes et de la terre au temps des épices, de la canne à sucre, puis du cacao.

Mais São Tomé, modeste africaine, enseigne ce que le temps et la nature peuvent faire de l’orgueil des hommes : le réduire à quelques vestiges délabrés. Au gré de l’île, cernés par la végétation, des bâtiments démesurés, incroyable patrimoine, sont à l’abandon. Des maisons de maîtres, des hôpitaux, des chapelles, des entrepôts jusqu’où courent des rails de chemin de fer sertis dans les pavés… Les roças, immenses plantations, couvraient des milliers d’hectares dédiés au cacaoyer importé du Brésil en 1822. Au début du XXe siècle, São Tomé-et-Príncipe, premiers producteurs mondiaux de cacao, devinrent “les îles chocolat” au prix de milliers de vies venues d’Angola, du Mozambique ou du Cap-Vert, d’abord asservies par l’esclavage, puis par des “contrats” iniques. Les longs baraquements qui les logeaient sont encore occupés par des descendants.

Agua Izé fut l’une des plus grandes de ces roças de la côte est, et José, né au Cap-Vert il y a soixante-dix-huit ans, en a tout connu. Avec sa fine moustache, ses longs cheveux blancs noués en natte qui tombe sur son torse nu, il ressemble à un vieux pirate. Il a travaillé dans les vergers, a conduit les trains qui reliaient les plantations aux séchoirs, fut surveillant et employé dans l’hôpital qui dresse encore son escalier monumental et sa façade néo-classique ouverte à tous les vents. Il a vécu la servitude de la colonie, les joies de l’indépendance en 1975, les espoirs d’un régime marxiste qui a tout laissé perdre, le libéralisme souvent corrompu… “J’ai tout gardé là”, dit-il en serrant le poing contre son coeur. C’est pour lui et les exilés que Cesária Évora chantait “ce long chemin pour São Tomé” et la nostalgie d’une terre lointaine au Cap-Vert : Sodade…

Mais certaines roças portent un présent plus souriant lorsqu’elles deviennent hôtel ou restaurant. Comme celui de João Carlos Silva, célèbre grâce à ses émissions culinaires pour la télévision portugaise. L’homme au bandana rouge et au visage sombre des “angolares”, ces descendants de marrons qui avaient fui l’esclavage et se sont faits pêcheurs, forme des jeunes de son village à une gastronomie qui marie l’espadon ou le thon à tous les légumes et fruits de l’île. C’est chez lui que l’on découvre la saveur reine de l’archipel, le chocolat de Claudio Corallo, vénéré par des chefs du monde entier. Cela aussi est un voyage : le goût puissant porte toutes les richesses végétales des tropiques – bois, humus, fleurs… L’ingénieur agronome, qui a quitté sa Toscane natale en 1974 pour se lancer dans la caféiculture au Zaïre, vit ici depuis les années 1990.
Comme dans un tableau caribéen
À une demi-heure d’avion à hélices, l’île cadette, Príncipe, 9 000 habitants tout au plus, est un autre bout du monde, plus languide encore. La “capitale”, Santo António, est un village lové autour de sa baie, dos à la forêt. Les maisons aux tons pastel et les rues propres ignorent la cohue. Entre Antilles et Afrique, une échoppe ou un café laissent échapper une musique imprégnée de rumba congolaise, de roucoulements du zouk-love ou de battements du kuduro d’Angola. Lors de la messe du dimanche, dans l’église blanche, le seul curé de l’île lutte en chansons contre la concurrence des adventistes et évangélistes présents jusque dans les hameaux.

Sur les hauteurs, au bout d’une piste de terre ocre, la plantation de Claudio Corallo domine une côte de pains de sucre dressés face au large. Les arbustes et les cabosses profitent de la brise marine, les fèves fermentent et sèchent sous les hangars. Quand il est là, l’homme aux allures de prince florentin “campe” dans l’ancienne maison de maître posée sur sa colline, avec ses murs décrépis, ses fenêtres privées d’huisseries mais qui encadrent un paysage de belle solitude, entre les arbres pour perroquets et le ciel bleu que fendent les aigrettes blanches. Car ici, la jungle est bienveillante, sans animal venimeux, peuplée de dizaines d’espèces d’oiseaux colorés dont vingt-cinq endémiques. Elle exhale les parfums de l’ylang-ylang et des orchidées sauvages après la pluie du matin. Les fonds marins sont riches pour les pêcheurs dans leurs pirogues taillées aux troncs des fromagers. À les voir glisser le long des grèves et des palmiers aux reflets de bronze, on a l’impression d’entrer dans un tableau caribéen de Peter Doig.

Les longues plages sont moins fréquentées par les baigneurs que par les tortues qui viennent en fin d’année pondre dans le sable blond. Dès le mois de septembre, Alcides, 26 ans, arpente celui de Praia Grande pour repérer les sites de ponte qui seront protégés des prédateurs, hommes ou animaux. Dans la petite cabane-musée posée sous les cocotiers, il explique régulièrement le grand voyage et le cycle de reproduction. Les touristes sont invités à laisser cinq euros pour participer à cet important projet de conservation. Désormais, affirme Alcides, les tortues rapportent plus vivantes que mortes.
Le pari de la nature et de la beauté
Car pendant que São Tomé rêve d’investissements chinois et de pétrole, Príncipe et ses îlots ont été déclarés réserve de la biosphère par l’Unesco en 2012, ayant ainsi fait le pari de la nature et de la beauté. Aidé en cela par un homme tombé de la lune, le Sud-Africain Mark Shuttleworth, qui après avoir fait fortune dans la high tech et s’être offert un séjour à vingt millions de dollars à bord de la station spatiale internationale en 2002, a décidé d’investir massivement à Príncipe (pour rallonger la piste de l’aéroport, construire une centrale électrique, installer internet…). Sa compagnie s’appelle HBD (pour “Here Be Dragons”) – inscription qui indiquait les territoires inconnus sur les cartes médiévales –, et gère trois superbes hôtels, des projets agricoles et forestiers, finance des formations pour les jeunes. Elle est devenue le premier employeur local : “Développer l’économie de manière durable, privilégier un tourisme respectueux de la nature et des traditions, assure Chris Taxis, le directeur général. Notre succès sera qu’un Santoméen dirige un jour l’organisation.”

On veut le croire sur parole en posant nos valises à la roça Sundy, une plantation reprise par HBD avant qu’elle ne soit transformée en exploitation d’huile de palme. Derrière des remparts dressés comme un château fort de cinéma, les hommes sont assis à l’ombre d’un arbre, sur le “banco ma língua” (le banc des palabres). Ces jours-ci, elles portent sur le projet soutenu par l’ONU de reloger 136 familles qui vivent dans les longs bâtiments vétustes face à la maison de maître convertie en hôtel. Ermelindo, 34 ans, est partagé : les demeures en bois seront plus confortables et saines, mais loin de la mer et des arbres nourriciers. Les 500 euros alloués semblent peu pour repartir de zéro. Cheira, la jeune femme qui s’affaire sur le brasero pour cuisiner sa divine soupe de poisson aux parfums de coriandre et de citron vert, dit qu’elle les investira dans un restaurant. La communauté a choisi le nom du futur lotissement : Terre promise.

Le nouvel hôtel, lui, a gardé la galerie, les beaux carrelages et les plafonds ouvragés de la maison de maître. Les colons portugais n’étaient pas que des brutes épaisses. Un jour de 1919, ils reçurent Sir Arthur Eddington, astronome britannique qui profita d’une éclipse pour être le premier à démontrer la théorie d’Einstein sur la relativité. On occupe la même chambre que lui, dont la véranda se perd dans les frondaisons des bananiers et des érythrines aux fleurs scintillantes comme des flammèches. Le soir, on plonge dans Equador, le roman de Miguel Sousa Tavares, pour retrouver les fantômes du passé. Au pied de la colline, l’un d’eux hante les ruines de Ribeira Izé, premier lieu où s’implantèrent les Portugais. De la demeure de Maria Correira, riche mulâtresse esclavagiste deux fois veuve qui, dit la légende, jeta un amant noir dans l’océan du haut d’un promontoire, il ne reste que quelques pans de murs et une volée de marches avalés par la forêt. Sur la plage, un pêcheur et son fils préparent filets et pirogue, indifférents à ce passé enfoui comme ils le sont à la pluie délicate. On dirait la chanson de Brel aux Marquises et l’on aimerait qu’elle dure longtemps.
Par
PIERRE SORGUE
Photographies
OSMA HARVILAHTI